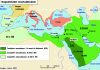Par Ali Bouzerda
Si Ibn Khaldoun, avec ses concepts sur la légitimité du pouvoir, la dynamique des empires et la cohésion sociale (ʿasabiyya), observait la création, l’évolution et la structure de l’État d’Israël, quelle analyse pourrait-il en faire ?
En ce dimanche 20 juillet 2025, période estivale par excellence, des milliers de familles marocaines ont déserté les plages de Rabat, Salé et Mohammedia pour participer à une marche nationale de soutien au peuple palestinien. Un geste de solidarité qui témoigne des liens profonds et durables entre peuples, de l’Atlantique au Golfe.
Dans ce contexte, un article du Monde Diplomatique intitulé « Que cherche Tel-Aviv au Proche-Orient ? » a attiré mon attention en comparant Israël à Sparte, la petite cité guerrière de la Grèce antique.
Comme autrefois Sparte, Israël vit dans un état de vigilance militaire constant, entouré de « voisins hostiles », et justifie sa politique sécuritaire par “une menace permanente”.
À la différence de Sparte, Israël est une forteresse bardée de technologies, hérissée de capteurs et de murs d’acier — et pourtant, le 7 octobre 2023, le Hamas a franchi ce rempart que l’on croyait impénétrable.
Dans un dialogue avec ChatGPT, il m’avertit que cette comparaison est avant tout symbolique : pertinente sur le plan militaire et géopolitique, elle ne saurait être une équivalence historique. Sparte, rappelle-t-il, avait conquis la Messénie et réduit ses habitants à l’esclavage, instaurant un régime fondé sur la domination d’une majorité soumise, les Hilotes. Une situation qui résonne étrangement avec celle des Palestiniens.
Je l’interroge alors sur la vision cyclique de l’histoire d’Ibn Khaldoun appliquée à Israël.
Voici la synthèse de son analyse.
Dans la première phase, de 1948 aux années 1970:
Israël a vu le jour en 1948, dans le sillage de la déclaration Balfour de 1917 et sous le mandat britannique en Palestine, qui a facilité, puis encadré l’immigration juive en Terre sainte. L’État se construit sur une forte cohésion nationale juive. C’est « l’âge héroïque », celui de la solidarité, des kibboutz, des guerres d’expansion territoriale…Selon Ibn Khaldoun, c’est la phase de naissance, où l’État tire sa légitimité de la ʿasabiyya.
Israël devient une puissance technologique et économique, tout en renforçant son appareil militaire. Mais cette prospérité s’accompagne d’une fragmentation politique croissante, de tensions internes et d’un affaiblissement progressif de la cohésion sociale. C’est le sommet du cycle.
Enfin, depuis les années 2020 : les signes d’un déclin apparaissent.
Divisions internes profondes, tensions identitaires, polarisation politique, mouvements de protestation massifs, et une dépendance stratégique accrue aux États-Unis.
ChatGPT souligne que cette dépendance, longtemps inconditionnelle, devient aujourd’hui plus fragile, en particulier face aux critiques croissantes de l’opinion publique américaine et des fractures au sein du parti démocrate, suite aux images de violence exercée par l’armée israélienne et dont les Palestiniens sont victimes depuis le 7 octobre 2023 (60.000 morts et 130.000 blessés en majorité des civils inoffensifs).
L’impasse israélo-palestinienne est au cœur de cette fragilisation. Israël maintient son contrôle sur Gaza et la Cisjordanie, sans intégrer les Palestiniens, ni leur accorder de véritable souveraineté.
Cette situation rappelle la position spartiate : une puissance technologique avancée gouvernant, par la force, une population qu’elle ne peut ni assimiler ni éliminer, relève l’IA.
Sparte n’a pas été vaincue de l’extérieur, mais rongée de l’intérieur par les tensions sociales et la révolte des dominés. Pour Ibn Khaldoun, un État entre dans sa phase de décadence lorsqu’il s’appuie uniquement sur la coercition, faute de cohésion interne.
Israël se trouve donc à un tournant historique. Tant que la question palestinienne reste irrésolue, elle continuera de miner l’unité nationale, d’alimenter les tensions internationales (guerre avec le Liban, la Syrie, le Yémen et l’Iran) et d’épuiser la société israélienne de l’intérieur.
Cependant, le cycle khaldounien n’est pas irréversible, signale ChatGPT : « Un État peut se régénérer s’il retrouve un projet commun fondé sur la justice, la solidarité et une vision partagée. »
Cela suppose pour Israël un choix clair : comment vivre avec ses voisins en paix, à commencer par les Palestiniens.
Comme l’a si bien souligné le Monde Diplomatique : « Netanyahou et ses pairs savent très bien qu’Israël ne sera jamais pleinement accepté dans la région tant que les Palestiniens n’auront pas obtenu justice. »
En bref, l’impasse et une absence de visibilité.
Il est à rappeler que dans un entretien accordé à Lyse Doucet, journaliste de la BBC et diffusé en août 2013 à l’occasion de ses 90 ans, Shimon Peres a livré ses craintes profondes sur le devenir d’Israël, notamment face à un conflit permanent avec ses voisins, l’expansion des colonies de peuplement et la montée de la méfiance mutuelle.
Selon lui, « le principal obstacle à la paix reste la méfiance mutuelle, accrue par les implantations et l’absence de dialogue réciproque de confiance avec les Palestiniens. »
Il réaffirme fermement l’importance de la solution à deux États comme « unique voie viable pour mettre fin au conflit. »
Et d’ajouter qu’il faut ce dialogue « dès maintenant », avant qu’il ne soit trop tard.
Mais porté par une vision de pouvoir intransigeante aux conséquences désastreuses, Netanyahou semble aujourd’hui ignorer les avertissements de son défunt collègue, le président Shimon Peres, artisan de la paix avec Yasser Arafat et témoin privilégié des accords de Camp David avec l’Égypte d’Anouar el-Sadate — des efforts auxquels le Maroc, en coulisses, avait apporté sa médiation discrète.
Et pour revenir à Sparte, le fin mot de l’Histoire : après la conquête de la Grèce par Rome (officiellement en 146 av. J.-C.), Sparte perd toute influence politique ou militaire. Elle est intégrée à la province romaine d’Achaïe, et son statut n’est plus celui d’une puissance, mais d’une curiosité touristique…
Article19.ma