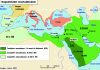Pour les anciens Grecs, les Romains, et d’autres civilisations, les rêves n’étaient pas de simples fantaisies nocturnes. Ils représentaient des expériences puissantes, souvent sacrées, qui influençaient la vie quotidienne, la politique, les pratiques religieuses et l’art.
Bien que les gens de l’Antiquité rêvaient probablement de thèmes similaires aux nôtres — amour, peur, mort, pouvoir, divin — leurs songes étaient largement perçus comme des messages importants, souvent considérés comme venant directement des dieux ou de forces surnaturelles.
Les rêveurs de l’Antiquité cherchaient à interpréter ces visions, y trouvant des réponses à des maladies, des dilemmes moraux ou des questions d’État, et agissaient en conséquence avec un grand sérieux.
Messagers divins et prophéties
L’un des types de rêves les plus fréquents dans l’Antiquité mettait en scène des figures divines ou semi-divines livrant un message — ce que des penseurs romains comme le savant Macrobe qualifiaient d’« oracles », et que des chercheurs modernes appellent des « rêves d’épiphanie ». Ces rêves impliquaient généralement un dieu, un ancêtre ou une figure vénérable annonçant des événements futurs ou prescrivant des actions à entreprendre.
Un exemple célèbre se trouve dans l’Odyssée d’Homère, où Pénélope rêve qu’un aigle tue son troupeau d’oies. L’aigle parle ensuite, se révélant comme Ulysse, annonçant son retour et sa vengeance.
Autre exemple, en Sumer antique, le roi Eanatum Ier rêva que le dieu Ning̃irsu — divinité sumérienne des orages et inondations — lui promettait la victoire en guerre.
En Égypte, au XVe siècle avant notre ère, un dieu apparut en rêve au prince Thoutmôsis IV, lui promettant qu’il deviendrait pharaon s’il libérait le Sphinx ensablé.
Dans certains écrits chrétiens anciens, les rêves étaient aussi perçus comme des supports d’enseignement moral, bien qu’il soit parfois difficile de faire la distinction entre rêves nocturnes et visions spirituelles.
Il n’était pas rare que les rêves façonnent les débuts de la religion : le général Ptolémée Ier Sôter, compagnon d’Alexandre le Grand, rêva d’une statue géante, ce qui le mena à fonder le culte de Sérapis…
Symbole et allégorie
Tous les rêves dans le monde antique n’étaient pas considérés comme directs ou évidents. Certains étaient vus comme des énigmes symboliques nécessitant une interprétation.
Le théoricien des rêves du IIᵉ siècle, Artémidore, dans son ouvrage Oneirocritica (L’Interprétation des rêves), faisait la distinction entre les rêves directs (appelés « théorématiques ») et les rêves allégoriques.
Les premiers pouvaient montrer précisément ce qui allait arriver — par exemple, rêver d’un naufrage et se réveiller pour découvrir qu’il s’est réellement produit. Les seconds, en revanche, masquaient leur signification sous forme de métaphores.
Dans les rêves symboliques, une chose en représentait une autre : un aigle pouvait symboliser un roi ; un voyage, un changement à venir ; une inondation, des troubles intérieurs.
Fait intéressant, l’interprétation ne reposait pas sur des significations fixes, mais sur le contexte — à savoir qui était le rêveur, son état émotionnel, son statut social, sa santé et ses préoccupations personnelles.
Source: Historic Facts
Article19.ma