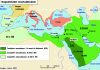Adnan Debbarh poursuit son plaidoyer percutant pour une souveraineté narrative marocaine affranchie des récits imposés. Entre silences coloniaux et histoire officielle, il appelle à reprendre la main sur le passé, non pour le mythifier, mais pour le comprendre, en faire un levier d’émancipation, de pluralité et de liberté.

Il existe des dominations visibles : celles qui se traduisent par des contraintes, des lois, des frontières. Et il en est d’autres, plus discrètes, plus durables : celles qui façonnent les récits. Depuis trop longtemps, le Maroc avance dans l’histoire avec des mots qui ne sont pas les siens, des concepts qui lui sont étrangers, et des silences qui ne sont pas innocents. Car toute domination commence par un langage imposé : celui qui définit à ta place ce que tu es, ce que tu fus, et ce que tu dois devenir.
Le récit colonial a immobilisé le Maroc dans un archaïsme artificiel, qu’il fallait moderniser, dompter, extraire de sa propre temporalité. Cette fabrication d’un Maroc éternellement traditionnel justifiait la mission civilisatrice, tout en niant les dynamiques historiques internes de la société marocaine. Plus tard, l’État indépendant, en quête de légitimité, a reconstruit un récit officiel, vertical, héroïque, qui gomme les conflits, les résistances marginales, les voix plurielles. Entre ces deux récits apparemment opposés, une continuité sourde persiste : l’effacement des Marocains comme sujet de leur propre histoire. De l’un à l’autre, c’est la même violence symbolique : l’histoire comme récit captif, jamais comme récit libéré.
Chaque génération hérite non seulement de terres ou d’institutions, mais d’un récit. Ce récit dit ce qui a compté, ce qui a été vain, ce qui mérite mémoire ou oubli. Il trace des frontières invisibles entre le dicible et l’indicible, le légitime et l’illégitime. Mais un récit hérité ne suffit plus. Dans un monde bousculé par les recompositions géopolitiques, les récits nationaux deviennent des vecteurs de souveraineté ou des angles morts de la dépendance. Un peuple qui ne maîtrise pas son propre passé est condamné à emprunter ceux des autres , et donc , à vivre à crédit.
Or, le Maroc vit encore sous le joug d’une histoire désappropriée. Les archives sont dispersées, les mémoires mutilées, les manuels scolaires souvent muets sur les blessures ou les grandeurs invisibles. Comment construire un avenir lorsque le passé est une terre étrangère ? Le peuple n’accède à son passé que par fragments : des anecdotes orales, des séries télévisées édulcorées, des commémorations ritualisées. Rien qui fonde une souveraineté du sens.
C’est là qu’il faut poser la vraie question : à qui appartient notre histoire ?
Réécrire l’histoire ne veut pas dire la falsifier, encore moins l’instrumentaliser. Cela veut dire reprendre la main sur les chronologies, les voix, les symboles. C’est accepter que le passé ne soit pas un bloc monolithique, mais une polyphonie. Non pas pour glorifier, mais pour comprendre. Non pour fuir les conflits, mais pour les nommer. Non pour unifier de force, mais pour articuler les diversités.
Il faut rompre avec le récit assigné, qu’il vienne du dehors (l’exotisme orientaliste, le récit colonial) ou du dedans (le nationalisme autoritaire, l’histoire officielle). Ce refus de la tutelle n’est pas seulement une posture intellectuelle : il est une condition de la souveraineté narrative.
Cette souveraineté narrative n’est pas un luxe : elle est une nécessité géopolitique, diplomatique, identitaire. Un pays qui ne se raconte pas laisse d’autres le faire à sa place.
C’est ici que l’histoire redevient centrale. Non pas l’histoire scolaire, linéaire et glacée, mais l’histoire comme quête de sens et exercice de liberté. Il ne s’agit pas de produire une nouvelle vérité d’État, mais de laisser réémerger les mémoires enfouies, les douleurs non dites, les fiertés occultées.
Cela exige une génération d’historiens libérés des grilles coloniales, des dépendances universitaires, des censures implicites. Des historiens capables de penser les failles et les continuités, d’écrire avec rigueur mais sans tutelle.
Leur rôle est immense. Car sans eux, le récit national ne peut qu’être mythologique ou mutilé.
Je leur adresse ici un appel :
Rejoignez ce moment. Il est temps de dire l’histoire, non pour solder les comptes, mais pour ouvrir un avenir. Il est temps d’oser la pluralité narrative, non comme dispersion, mais comme force.
Le Maroc a commencé à se doter d’institutions muséales, d’espaces de mémoire, de projets archéologiques. C’est un début. Mais la souveraineté narrative ne s’écrit pas qu’avec des vitrines et des catalogues. Elle demande des choix politiques, des lieux de débat, des passerelles entre les disciplines. Elle demande surtout une confiance dans l’intelligence du peuple, capable de lire, de comprendre, d’assumer.
Car ce peuple n’attend pas des leçons, mais un récit où il se reconnaît, dans ses douleurs comme dans ses grandeurs.
L’histoire n’est pas un territoire figé. C’est un chantier vivant, une conscience en mouvement. La souveraineté, dans sa forme la plus haute, commence là : quand un peuple ose enfin se dire.
Source : Quid.ma
Article19.ma